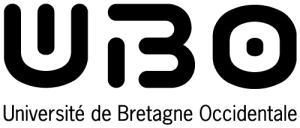- Trainer/in: Elizabeth Mullen
..
- Trainer/in: Alain Kerherve
- Trainer/in: Helene Machinal
- Trainer/in: Camille Manfredi
- Trainer/in: Elizabeth Mullen
- Trainer/in: Kimberley Page-Jones
- Trainer/in: Lionel Souquet
L’objectif de ces séminaires est de porter, dans un premier temps, une réflexion théorique sur les notions d’identité-race-altérité, puis de les mobiliser et les contextualiser à la lumière des grands mouvements qui ont jalonné l’histoire contemporaine de la Caraïbe anglophone, francophone et hispanophone.
- Trainer/in: Nathalie Narvaez
- Trainer/in: Maria Fatima Rodriguez
M2 : Intermédialité(s)
Objectif pédagogique :
Identifier et analyser les enjeux cognitifs et les problématiques liés à l’intermédialité, la transmédialité et la plurimédialité ; concevoir une typologie critique des approches intermédiatiques, notamment – mais non exclusivement – dans la relation entre texte et image : relations synthétiques, formelles, transformationnelles et/ou ontologiques (Schröter).
Contenu :
Définitions : qu’est-ce qu’un médium ? Un support ou « dispositif » médiatique ? Qu’est-ce qu’une « relation » ou un « rapport » (inter)sémiotique ?
Le cours abordera la diversité et matérialité des différents régimes intermédiaux ; il posera les enjeux heuristiques d’une production de sens reposant sur des stratégies d’hybridation ou de métissage, de synchronicité ou asynchronicité, de transposition, combinaison, appropriation ou dépropriation, de prolifération médiatique, etc. On soulèvera également les problématiques liées aux dispositifs de remédiation propres au champ des « nouveaux » média (Bolter et Grusin).
Ces questions seront abordées au travers d’un historique des approches critiques de l’intermédialité depuis le dialogisme bakhtinien au « bricolage » de l’ère post-nationale de Mark Deuze, en passant par l’intertextualité de Kristeva, l’intericonicité de Panofsky, les travaux de Liliane Louvel sur l’iconotextualité, ceux d’Agamben sur le dispositif, l’approche médiologique de Debray et la « généanalogie » d’Eric Michoulan.
Les récents travaux du CRI de l’Université de Montréal, trop nombreux pour être cités ici, seront particulièrement utiles et éclairants pour intéresser les étudiants aux problématiques vertigineuses soulevées par les relations entre texte et image, mais aussi entre texte, image et son ; on pourra enfin envisager d’étendre la réflexion à l’entrée de l’haptique et de l’olfactif dans les arts plastiques intermédiaux.
Bibliographie (très) sommaire :
Giorgio Agamben, Qu'est-ce qu'un dispositif ?, trad. Martin Rueff, Paris, Rivages, 2007
Jay David Bolter et Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, MIT Press, 1999, 2000
Bernard Guelton (dir.), Fictions et médias : Intermédialités dans les fictions artistiques, Publications de la Sorbonne, 2011
Louis Hébert, Lucie Guillemette (dir.), Intertextualité, interdiscursivité et intermédialité, Presses Universitaires de Laval, 2009
Liliane Louvel, Texte/Image. Images à lire, textes à voir, PUR, 2002
Liliane Louvel, Le Tiers pictural : Pour une critique intermédiale, PUR, 2010
Éric Méchoulan, « Intermédialité : ressemblances de famille », in Intermédialités : histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, Numéro 16, automne 2010, p. 233-259, http://id.erudit.org/iderudit/1001965ar
- Trainer/in: Elizabeth Mullen